

"Si nous savions ce qu'est un rayon de lumière, nous saurions beaucoup de choses". Louis de Broglie
Introduction I
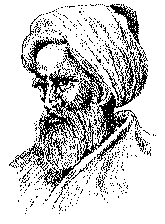

I. L'histoire de la nature de la lumière :
l’affrontement de deux théories
l’affrontement de deux théories
"Si nous savions ce qu'est un rayon de lumière, nous saurions beaucoup de choses". Louis de Broglie
Introduction I
D
e tout temps, les hommes se sont intéressés à la lumière. En vingt-cinq siècles, les scientifiques
ont élaboré de nombreuses théories autour de la lumière. Les plus anciennes datent de l’antiquité
vers le 5ème siècle avant JC, des savants comme Euclide, Aristote et Ptolémée, pensaient que la
lumière était formée de particules voyageant de l’œil jusqu’à l’objet. C’est seulement vers le
moyen-âge que le savant arabe Alhazen réfute les idées antiques, la lumière est émise par l’objet,
mais conservant la conception corpusculaire de la lumière, il est à l’origine de l’optique
géométrique.
A
insi, au fil des siècles, les théories vont se multiplier laissant apparaître les deux théories
fondamentales de la lumière : la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire de la lumière.
Cette première est soutenue par Newton eu 17ème siècle, celle-ci permet notamment d’interpréter
la propagation rectiligne de la lumière avec les particules qui la compose. Cette théorie interprète
bien les phénomènes de réflexions et de réfraction. C’est sur cela que Newton formule la théorie des
couleurs (prisme). Cette théorie a duré un siècle, mais par manque de preuve et faute de matériel,
elle fut très vite concurrencée par la seconde. En effet en 1678, le savant hollandais Christiaan
Huygens conçoit une théorie admettant que la lumière est une onde se propageant dans l’éther. A
l’époque, Newton domine. Mais en 1801, la nature ondulatoire de la lumière est mise en évidence
par certaines expériences telles que celle de Young et ses interférences et celle de Fresnel avec la diffraction. Il
existe donc un véritable combat entre deux théories, mais une seule peut interpréter la réalité,
nous verrons comment les bases théoriques sur la nature de la lumière se sont posées.
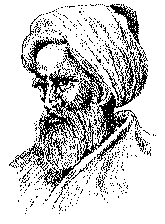
Fig.1, Alhazen

Fig.2, Euclide